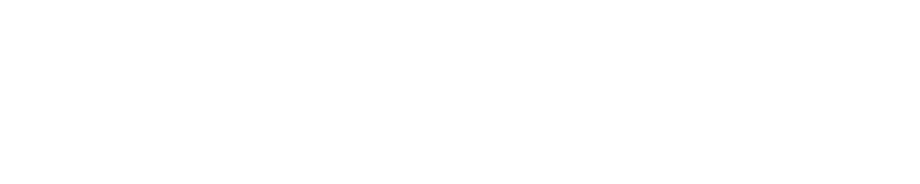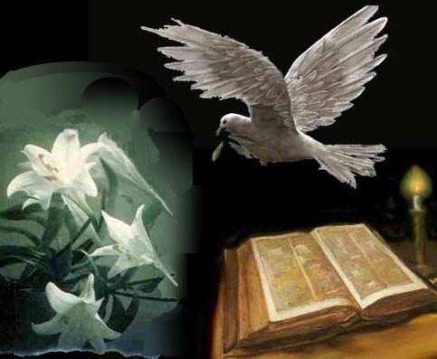Savons-nous ce que nous faisons ?
|
|
« Savons-nous Ce que nous faisons ? » Le codex de Bèze Luc 1 : 1-11 |
Introduction :
Parmi tous les manuscrits importants des évangiles et des actes des apôtres qui nous sont parvenus (cf. On dénombre environ 24000 fragments, portions de manuscrits et de textes plus complets), il en est un qui nous interpelle. Il s’agit du codex de Bèze. Ce codex compte deux volumes et couvre tous les récits des évangiles et du livre des actes des apôtres. Il est rédigé en grec sur la gauche, et en latin sur sa droite. Ce codex manuscrit, remarquablement complet, remonterait au 2è s. de notre ère, même si certains le date entre le 5 et 6 -ème siècle (« On peut aisément remonter bien des leçons uniques du Codex de Bèze au IIe siècle, suivant le témoignage des anciennes versions latines (it), syriaques(sys.pal.hmg) et coptes (comae) qui en sont les meilleurs garants, ainsi que des pères grecs et latins, tels Irénée et Tertullien », de Josep Rius-Camps, faculté de théologie de Catalogne).
Est-il le plus ancien témoin grec et latin ? Laissons les spécialistes en débattre (Son nom est rattaché à Théodore de Bèze, humaniste, théologien protestant, traducteur de la Bible. Il fut aussi professeur, ambassadeur, poète, successeur de Calvin, il fut recteur de l’académie que ce dernier avait fondée à Genève, en 1559. Ce codex, il l’avait eu sous sa sauvegarde lors des guerres de religion en 1562).
L’important pour nous est de considérer ce codex comme un outil de référence précieux. Ainsi, au chapitre 6 de Luc, nous trouvons un ajout significatif des paroles de Jésus. Elles s’harmonisent bien avec l’ensemble de son enseignement. Alors, que cet ajout soit authentique ou pas, qu’importe ! Saisissons l’occasion pour nous laisser interpeler par ce texte qui a traversé les siècles dans la pensée chrétienne… Voici donc le texte en question :
« Ce même jour, il vit un homme qui travaillait pendant le sabbat ; il lui dit : Si (vraiment) tu sais ce que tu fais, heureux es-tu (ou bénis sois-tu) ; mais si tu ne le sais pas, tu es maudit, transgresseur de la loi ». Luc 6 : 5, codex de Bèze.
Développement :
La question qui naturellement nous vient à l’esprit est la suivante : pourquoi ce texte se trouve-t-il dans ce codex et non dans d’autres manuscrits ? Cela est d’autant plus pertinent que Luc au début de son évangile nous dit avoir fait des recherches exactes. N’a-t-il pas entrepris de composer un récit des faits authentiques, après s’être informé et documenté sur tout depuis les origines ? (Cf. Luc 1 : 1-4). Essayons de comprendre ?
Sans sortir d’une faculté de théologie, on peut avancer deux simples hypothèses : soit cette phrase a échappé aux recherches de Luc, soit cette phrase était à l’origine de son écrit, et elle a été supprimée par la suite, parce qu’elle gênait. Sans faire de l’interprétation fiction, admettons que le contenu de ce logion pouvait être très dérangeant pour l’époque, (surtout dans un contexte d’attachement à la loi, dite faussement de Moïse qui n’a été qu’un canal de transmission !). Replacée dans le contexte historique du temps du Christ, cette précision pouvait être inacceptable par les autorités religieuses.
Elle peut l’être tout autant aujourd’hui, pour tous ceux qui considèrent que Jésus est venu abolir la loi. Disons encore que la révélation de Jésus-Christ sauveur du monde, a été facteur de tensions dès le premier siècle. Il faut savoir que très tôt le monde chrétien a éprouvé le besoin de se démarquer de tout ce qui pouvait s’apparenter à une culture typiquement juive. En raccourci, disons que la loi a été supplantée par la foi. En fait, ce texte est dérangeant aussi bien pour des Juifs, que pour des Chrétiens. Il renvoie précisément à une responsabilité face à ce que Dieu a édicté (d’un côté les Juifs avaient rendu imbuvable l’observation du sabbat, de l’autre la tentation des chrétiens de le remplacer pour ne pas ressembler aux Juifs l’a emporté dans les siècles suivants). Or, précisément, les paroles du Christ sont une mise en garde contre toute tentation irréfléchie de l’abandon de la loi des 10 commandements, qualifiée de loi royale par l’apôtre Jacques (cf. Jacques 2 : 8).
Ce texte serait d’autant plus gênant qu’il revisite l’histoire… Il nous rappelle l’opposition des premières communautés chrétiennes face à la culture juive. Cette réaction hostile a été nourrie par le comportement des Juifs eux-mêmes à l’encontre des premiers chrétiens. Rappelons-nous : les premières persécutions des Romains ont été menées contre les Chrétiens avec la collaboration des Juifs, principalement de Jérusalem. En réaction, l’histoire évoque un retournement de situation. Un phénomène de rejet. Elle entraînera des conséquences regrettables (par exemple, le jour du sabbat, si cher aux Juifs contemporains du Seigneur, a été supplanté, dès le 2é siècle par le dimanche. Il a été adopté officiellement dans l’Empire romain au 4é siècle sous le règne de l’empereur Constantin. Mais, c’est sous le règne de l’empereur romain Théodose 1er Le Grand, que l’observation de ce jour fut définitivement institutionnalisée. Rappelons-nous que c’est ce même empereur qui décréta le 8 novembre 392, avec la bénédiction des évêques de Rome, le christianisme religion de l’Empire romain. En conséquence, tous les autres cultes furent interdits).
Dans ce contexte, la phrase de Jésus, (rapportée dans le codex de Bèze) nous fait réfléchir sur le sens de l’histoire des hommes. Elle confirme ce qui a, jadis, été acté. Elle dérange à la fois Juifs et Chrétiens. Essayons donc d’en comprendre les raisons.
« Si (vraiment) tu sais ce que tu fais… » Cette phrase est d’autant plus révélatrice qu’elle fait écho à une autre phrase historique du Seigneur en croix. C’est le même évangéliste Luc qui la rapporte : « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu’ils font. » Luc 23 : 34, version TOB.
Le drame de l’histoire humaine est résumé dans cette phrase. A la réflexion, on s’aperçoit que chacun peut se reconnaître. Nous avons beaucoup de difficultés à percevoir le sens profond du message du Christ et à en avoir une pensée immersive sérieuse. Sur la question du jour du repos, Juifs et Chrétiens se sont fourvoyés. Il est honnête de le reconnaître. A aucun moment le Christ n’est venu abolir le code moral (décalogue ou 10 commandements), écrit du doigt de Dieu au Sinaï, et transmis à Moïse. Il l’affirme lui-même (cf. Matthieu 5 : 17-19).
Pouvait-il en être autrement, quand on sait que le Seigneur n’a pas cessé de dire : « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m’a envoyé, et d'accomplir son œuvre. » Jean 4 : 34. « Je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas… » Jean 5 : 43 « Je suis descendu du ciel pour faire, non ma volonté, mais la volonté de celui qui m’a envoyé. » Jean 6 : 38, version LSG.
Comment Juifs et Chrétiens ont-ils pu à ce point se méprendre sur la compréhension et l’observance du jour de repos hebdomadaire ? Essayons de comprendre…
- Le peuple juif : Il est clair que le Seigneur a été perçu par les responsables juifs de l’époque comme un transgresseur du jour du sabbat. Ce constat fera partie des chefs d’accusation qui mèneront Jésus à la croix. Or, à aucun moment le Christ n’a été transgresseur de la loi de son Père, sinon cette transgression aurait rendu inopérante, voire caduque, la valeur de son sacrifice expiatoire pour chacun de nous. (Si le péché est la transgression de la loi (cf.1 Jean 3 : 4),et si le Christ avait commis l’irréparable, il ne serait pas ressuscité et son sacrifice aurait été vain).
A la vérité, le Christ a voulu redonner du sens à cette observation en la dépoussiérant du fatras des préjugés, ainsi que de la tradition des prescriptions rabbiniques. Elles avaient fait de ce jour un fardeau pesant, au lieu d’un jour de joie.
Le récit de Luc est éclairant sur ce point, Jésus questionne : « puis Jésus leur dit : " Je vous le demande : est-il permis, le sabbat, de faire le bien plutôt que de faire le mal, de sauver une vie plutôt que de la perdre ? » Luc 6 : 9, version FBJ.
A l’occasion de ce débat avec les chefs de l’époque, Jésus posera la bonne question : « pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition ? » Matthieu 15 : 3, version LSG. (Il pourrait nous la reposer aujourd’hui !).
Le Seigneur, voyant qu’il ne pouvait être entendu, prononça ces paroles douloureuses : « vous avez annulé la parole de Dieu au nom de votre tradition. Hypocrites ! Esaïe a bien prophétisé à votre sujet, quand il a dit : ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. C'est en vain qu'ils me rendent un culte, car les doctrines qu'ils enseignent ne sont que préceptes d'hommes. Matthieu 15 : 6-9, version TOB.
Dans ce contexte, le rajout du codex est éclairant. Il nous renvoie à notre responsabilité : savons-nous vraiment ce que nous faisons ? Est-ce que les Chrétiens ont fait mieux ?
- Le peuple chrétien : Malheureusement, l’histoire confirme que les Chrétiens ont aussi fait la mauvaise analyse, et curieusement pour les mêmes raisons. Pour des motifs politico-religieux, sous le règne de l’empereur romain Constantin, le sabbat ou samedi du Nouveau Testament a été remplacé par le dimanche. L’humain s’est accordé ce droit divin à modifier le décalogue pour l’accommoder à sa conception.
Eusèbe de Césarée, élu évêque de la ville de Césarée de Palestine entre 315 et 320, déclare dans son commentaire du psaume 92 : « Toutes les choses qu’il fallait faire le jour du sabbat nous les avons transposées au jour du Seigneur comme étant mieux approprié, vu qu’il a la priorité et le rang et qu’il est plus honorable que le sabbat des Juifs. »
Dans les querelles passées entre Protestants et Catholiques, Monseigneur de Ségur a eu beau jeu de déclarer lors d’une causerie sur le protestantisme d’aujourd’hui :
« Il est curieux de rappeler que cette observation du dimanche, qui est le seul culte du protestantisme, non seulement ne repose point sur la Bible, mais est en contradiction flagrante avec la lettre de la Bible qui prescrit le repos du sabbat ou samedi ». Protestantisme d’aujourd’hui p. 207. (Mais si le dimanche n’est pas le seul culte des Protestants !).
Les querelles sont maintenant et heureusement dépassées, mais la réalité demeure.
(Plus tard, l’Eglise dominante apostolique et romaine après avoir transposé le jour du repos, supprimera même le deuxième commandement sur les images taillées et dédoublera le dernier pour faire bonne mesure.) L’Eglise catholique justifiera son choix du dimanche, a posteriori, par une faible argumentation des textes, principalement de Jean 20 : 19 ; Actes 20 : 7 ; 1 Corinthiens 16 : 2. Sans être un théologien érudit, il est aisé de démontrer l’extrême faiblesse de cette argumentation. Cet aveu reproduit ce que le Seigneur avait déjà dénoncé concernant la position des autorités juives de son temps : à savoir que l’humain préfère suivre des préceptes d’hommes, des traditions humaines, plutôt que de respecter l’autorité de Dieu. (Même les dictionnaires, qui au milieu du 20éme s. disaient que le samedi était le 7ème jour de la semaine, ont rectifié leur définition en requalifiant le dimanche comme dernier jour de la semaine.) Pour se donner bonne conscience, des théologiens protestants, eux aussi, ont voulu contourner la difficulté, en spiritualisant le jour de repos.
La prophétie de Jésus sur la destruction de Jérusalem prouve que l’observation de ce jour n’était en aucune façon remise en question (cf. Matthieu 24 : 20). Soyons clairs aucun apôtre n’a acté un tel changement. Quoi qu’il en soit, aujourd’hui, le dimanche ne souffre aucune contestation au sein du christianisme… Faut-il dès lors s’en émouvoir ou peut-on réfléchir sereinement sur le sujet ?
« Si tu sais vraiment ce que tu fais, heureux es-tu… »
Le temps peut-il transformer une erreur en vérité ? Ce que Dieu n’a jamais fait, l’humain s’est arrogé le droit de le faire. Mais me direz-vous pourquoi donner tant d’importance à un changement de jour ? Apparemment, effectivement cela semble anodin, mais à la réflexion, cela ne l’est pas du tout. Pourquoi ? Essayons de voir clair ?
- Le repos du sabbat fait référence à un souvenir (cf. Ce mot a la même racine grecque que le mot vérité). Il renvoie à une volonté fondatrice : l’acte créateur (cf. Exode 20 : 8-11). C’est la genèse de notre histoire qui nous permet d’appeler Dieu, « notre Père qui es aux cieux » (cf. Matthieu 6 : 9) (Il est vrai que beaucoup ne croient plus, même dans les milieux chrétiens, à la création du monde par Dieu). Souvenons-nous pourtant que le sabbat est avant tout « le jour du repos de l’Eternel », avant d’être celui de l’homme. Dieu l’a posé dans le temps des humains pour qu’ils connaissent la naissance et la suite de leur histoire (la création tout logiquement aura une suite heureuse : l’établissement du royaume de Dieu). Dieu a mis à part (sanctifié) ce jour, et lui a accordé une bénédiction.( faut-il dès lors banaliser ce que notre Père a fait ?).
- Le repos du dimanche est en l’honneur de la résurrection. Ce n’est plus la même chose, ni la même histoire, d’autant qu’aucun mot de Jésus lui-même ne laisse entendre qu’il fallait célébrer sa résurrection par un jour. Le souvenir de la célébration de sa résurrection est rappelé par la cène (cf. 1 Corinthiens 11 : 23-26) et par le baptême par immersion (cf. Romains 6 : 3-10), (lui aussi dénaturé la plupart du temps).
Soyons clairs, il n’est pas question de raviver des querelles centenaires.
Cependant, permettez-moi d’apporter ici mon témoignage personnel : (Je ne suis ni juif, ni légaliste, ni rattaché à une communauté institutionnelle, et je ne suis pas sûr de célébrer le sabbat tel que Dieu le souhaiterait. Par contre, je reconnais la validité de ce bienfait de Dieu, assorti d’une bénédiction. J’ai rencontré des dignitaires catholiques qui m’ont confessé que mon analyse était cohérente avec la Bible. Je me souviens de l’entretien que j’ai eu à Paris, en 1968, au palais de la mutualité, avec le théologien renommé, feu le cardinal Daniélou (éminent théologien). Je lui ai posé la question : « pourquoi l’Eglise catholique n’observe-t-elle pas le sabbat des Ecritures Saintes ? » Il m’a répondu simplement « Dans la Bible le jour du repos est le sabbat, c’est incontestable, mais c’est l’Eglise catholique qui par autorité de Jésus-Christ a procédé à sa transposition au dimanche ». Sa réponse avait le mérite d’être en harmonie avec la tradition des pères de l’Eglise, je l’ai trouvée claire et honnête.)
« Si (vraiment) tu sais ce que tu fais, heureux es-tu (ou béni sois-tu) ».
Ce texte du codex de Bèze est pertinent, non seulement par le fait qu’il nous renvoie à des données historiques, mais plus encore parce qu’il met l’accent non pas sur le faire, mais sur la motivation du faire. Au-delà de toute interprétation, c’est le point le plus important. La question n’est pas d’observer ou pas le sabbat, la parole incisive du Christ porte sur le pourquoi on observe ce jour. Or, le citoyen lambda, sur un plan religieux, agit souvent par tradition. Après tout, pourquoi s’interroger sur la véracité des concepts ? Ce texte ravive notre responsabilité.
L’important est donc de savoir ce que l’on fait, et pourquoi ?
L’apôtre Paul est éclairant à ce sujet :
« Tel fait une distinction entre les jours ; tel autre les estime tous égaux. Que chacun ait en son esprit une pleine conviction » Romains 14 : 5, et plus loin « Tout ce qui ne vient pas de la foi est péché » (traduction littérale de l’original grec) Romains 14 : 23, version LSG. Avoir une pleine conviction dans ce que l’on fait, c’est être en résonance ou en cohérence avec soi-même. C’est être en harmonie avec la foi. C’est ce qui procure sérénité et bonheur. Seulement, prenons la précaution de ne pas isoler le rajout du codex de Bèze de son contexte (cf. l’entretien de Jésus avec les pharisiens).
A l’analyse, redisons-le, le sujet porte moins sur le sabbat, que sur la conviction concernant cette observance. (Avoir une pleine conviction : πληροφορείσθω = πληροφορεω = au passif comme c’est ici le cas, c’est être pleinement convaincu, avoir une conviction pleine et entière. Cela renvoie à ce qui est plein, abouti etc.).
Ainsi, dans la discussion du Maître avec les Pharisiens, le problème était moins centré sur la transgression du jour du sabbat, que sur le manque de foi dans l’adhésion à la loi divine, afin d’en déceler le sens profond.
Jésus ne l’a-t-il pas illustré avec le commandement sur l’adultère.
« Vous avez appris qu’il a été dit : Tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. » Matthieu 5 : 27-28, version LSG. (L’intention devient plus importante que l’action !).
Dans une autre circonstance, le Seigneur a osé absoudre une femme surprise en flagrant délit d’adultère. Il aurait dû, d’après la loi, la condamner, il n’en fut rien (cf. Jean 8 : 1 -11).
Dans le codex de Bèze, c’est pareil ! Le Christ ne condamne même pas celui qui travaille le jour du sabbat, il l’interroge sur le pourquoi il le fait. Mais, il savait que pour les responsables religieux cela provoquerait le scandale…
Que faut-il déduire de ces exemples, sinon que le Seigneur n’a pas fait porter sa réflexion sur la transgression, mais sur la motivation qui a conduit à la transgression. Dans le cas de la femme adultère, Jésus transforme la condamnation en appel à la repentance, et dans le texte du codex, il transforme aussi une condamnation en réflexion. Il éveille la conscience de cet homme, en stimulant sa responsabilité.
Se dégager des formes traditionnelles et apprendre à cheminer vers la compréhension du fond des paroles de Dieu, telle est l’invitation qui ressort de la phrase du codex de Bèze.
Conclusion :
A l’évidence, cet ajout du codex de Bèze apporte un éclairage novateur sur notre façon de lire les Saintes Ecritures. Notre responsabilité ravivée, porte désormais davantage sur le fond du message à comprendre, que sur sa forme. La question du sabbat ne repose pas sur une simple observance. Pour savoir ce que l’on doit faire (comme le texte nous y invite), nous devons nous reporter à ce que Dieu a fait.
« Dieu acheva au septième jour son œuvre, qu'il avait faite : et il se reposa au septième jour de toute son œuvre, qu'il avait faite. Dieu bénit le septième jour, et il le sanctifia, parce qu’en ce jour il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. » « Dieu vit tout ce qu’il avait fait et voici, cela était très bon » Genèse 2 : 1-3 et 1 : 31, version LSG.
Autrement dit, la célébration du sabbat n’est pas dans la forme, mais dans l’esprit qui l’anime. Dieu nous renvoie à sa joie, à la contemplation de son œuvre, au bonheur indicible ressenti en conclusion de sa création. Sa volonté s’est exprimée, qu’en faisons-nous ?
C’est dans ce sens que le Seigneur a pu dire : « le sabbat a été fait pour l'homme (non pour le Juif), et non l'homme pour le sabbat, de sorte que le fils de l'homme est aussi Seigneur (dans l’original, κύριος = kurios = Seigneur, voire Jean 21 : 7) du sabbat » Marc 2 : 27-28, version DRB. (Ce texte renvoie à la participation du Christ à l’origine de la création de l’univers).
Il n’a jamais été dit que le sabbat a été fait pour le Juif (le peuple hébreu ne portait pas encore le nom d’Israël au Sinaï ! Dieu a donc inscrit ce jour dans le temps des hommes, pour que l’humanité entière participe à son extase, lors de l’achèvement de la création du monde. Et comme les apôtres (cf. Jean et Paul) ont attesté que toute la création a été faite avec le concours de Jésus et par lui (cf. Jean 1 : 3 ; Colossiens 1 : 15-17), nous comprenons que le Seigneur Jésus, non seulement ne pouvait se dédire, mais voulait attirer l’attention de ses contemporains sur la réalité heureuse de la naissance du monde.
En épousant cet état d’esprit, on ne peut qu’être heureux. Cette réalité spirituelle indique que cette création aura une suite heureuse. Il convient de s’en réjouir ici et maintenant. La foi étant adhésion au plan de Dieu. Le plan de Dieu ne s’apparente pas à un disque informatique qui programme la machine humaine, car dans ce cas nous ne serions responsables de rien (comment savoir ce que je fais, si je ne suis pas libre !). Dieu par amour veut nous transmettre, comme un bon pédagogue, une connaissance. C’est elle qui éclaire notre discernement et donne du sens à nos pratiques quotidiennes. Apprendre pour comprendre, et comprendre pour adhérer de tout cœur, tel est le merveilleux projet de Dieu, mis en œuvre par Jésus-Christ et soutenu constamment par le Saint-Esprit.
« Si (vraiment) tu sais ce que tu fais, heureux es-tu… ».
Nous repositionner dans un état d’esprit qui donne plus d’importance à l’esprit qu’à la lettre, tel est l’enseignement de cette phrase oubliée. L’obéissance stricte et inflexible n’est rien, sans l’esprit saint qui l’anime et la fait vivre harmonieusement.
Jacques Eychenne
PS : LSG, version Louis Segond, 1982 ; FBJ, version Française de la Bible de Jérusalem ; TOB, version Traduction Œcuménique de la Bible ; DRB, version John Nelson Darby.