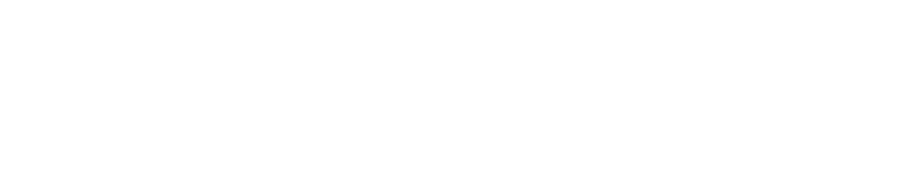Les bienfaits du pardon
|
|
Le pardon ou La libération par-don Matthieu 6 :14
|
Introduction :
S’il est un sujet qui taraude bien les consciences, c’est assurément celui du pardon. Le pardon, dans toute sa complexité, met en évidence toutes nos difficultés relationnelles. Le pardon, dans son application pratique, est aussi varié, qu’il y a d’individus sur notre planète. Certes, les psychologues, psychothérapeutes, psychanalystes, tracent bien des pistes communes, mais au final, cela restera toujours une affaire personnelle. Entre le pardon attendu par les uns et le pardon refusé par d’autres, entre l’agresseur et l’agressé, le traître et le trahi, l’humilié et l’humiliant, il y a toute la panoplie des variantes, enrobées de multiples ressentis.
Entre le simple pardon qui s’apparente à l’excuse, et le pardon impossible qui relève de l’impardonnable, toute la gamme des difficultés humaines s’étale au grand jour. Cela ne fait que révéler notre incapacité à bien vivre en relation avec autrui…
Se saisir de cette question relève du défi, car chacun de nous, un jour ou l’autre y sera confronté. Cela part du simple malentendu qui s’infecte, jusqu’ aux chocs terribles des génocides, des viols, des agressions lourdes et irréversibles.
Dès lors faut-il tout pardonner ? Ou encore, est-ce que tout est pardonnable ? Peut-on parvenir à tout pardonner ? En tant que chrétien engagé, comment trouver un chemin de paix ?
C’est à la lumière des Saintes Ecritures et de l’exemple du Christ que nous allons aborder le sujet.
Développement :
Comme à notre habitude, précisons d’abord le sens du mot pardon. Pour éviter un développement trop important, nous allons nous restreindre aux termes employés dans le Nouveau Testament. Il y a le substantif pardon et son verbe pardonner.
- Le pardon : αφεσις : peut être traduit par libération, rémission, remise.
(Le dictionnaire grec-français de A. Bailly, p. 324, rappelle que le sens profane et premier du terme est littéralement : laisser aller, laisser partir, renvoyer (un esclave), répudier une femme, décharger du service militaire, remettre une dette, une faute).
Dans le contexte spirituel, c’est la notion de liberté qui prévaut. C’est un peu comme si sortant de prison, nous étions remis en liberté non surveillée. Le verbe pardonner, qui traduit l’action du pardon, confirme cette dominance.
- Pardonner : αφιημι : faire sortir ou partir, laisser de coté, négliger, omettre, remettre une dette, les offenses, laisser, quitter, abandonner. Dans le langage profane, le grec utilisait ce verbe pour renvoyer un esclave, ou laisser à quelqu’un son indépendance. L’action de procéder à une expulsion conduit à un concept de liberté.
Dans un contexte spirituel, c’est redonner un espace de liberté. Théologiquement, le pardon recouvre une double réalité.
Il y a le pardon fraternel. C’est le pardon que l’homme accorde à un autre homme (l’offenseur). Et il y a le pardon de Dieu : La source de tout vrai pardon est en lui et vient de lui. Cela nous renvoie à l’origine de la rupture de relation entre Adam et Eve et Dieu le Père. La volonté d’indépendance de nos premiers parents a créé un fossé que Dieu seul pouvait combler (cf. Genèse 3 : 9). Elle s’est transformée en opposition à Dieu. La décision de rupture de relation vient de l’homme (même s’il n’est responsable qu’en partie). Elle peut être considérée au premier degré comme une trahison (précisons que l’humain est invité à pratiquer le pardon, mais Dieu seul peut prononcer la rémission des péchés).
Tout est pardonnable dans la Bible à l’exception du péché contre le saint-Esprit. En bref, de quoi s’agit-il ? Peut-on préciser le tragique méfait ? L’évangéliste Marc donne l’explication de ce cas exceptionnel (cf. Marc 3 : 22-30).
Il s’agit d’une méprise intentionnelle qui consiste à identifier le Christ au prince des démons. Cette tragique confusion des scribes de Jérusalem, confusion qui inverse les données du bien et du mal, rendait inopérant le pardon de Dieu. En résumé, cette confusion ne permettait plus la réconciliation. Elle mettait en constat d’échec le plan du salut de Dieu, révélé par son fils Jésus-Christ. Le verset 30 atteste bien cette grave méprise.
Avant d’aborder les différentes étapes qui jalonnent la mise en place d’un vrai pardon, observons que ce sujet est en pleine actualité. On voit des peuples jadis opprimés réclamer une demande de pardon de la part de leurs agresseurs. Il y a même en Afrique du Sud une commission (appelée Vérité et Réconciliation) chargée d’étudier ces situations historiques. En Amérique les psy et travailleurs sociaux emploient le pardon pour aider les personnes à guérir et à se réconcilier. Au Canada, les pasteurs travaillent avec la justice pour mettre en présence, avant délibération de la cour, agresseurs et agressés. En France, les évêques français ont demandé pardon pour leur silence lors de la déportation des Juifs vers l’Allemagne et pour récemment des actes pédophiles.
En bref, c’est la première fois dans l’histoire que l’on assiste à des demandes de pardon collectives et nationales. Nous sommes bien au cœur de l’actualité tant profane que spirituelle.
Après ces considérations générales, abordons le cœur du sujet :
Comment pardonner à ceux ou celles qui nous ont profondément trahis, blessés ou agressés ?
Poser la question, c’est déjà, pour certains, faire acte de faiblesse. Il est plus facile, apparemment, de rester droit dans ses bottes. Pour d’autres, il faut beaucoup d’audace et de persévérance. Quoiqu’il en soit, ceux qui ont expérimenté la pratique du pardon, donné ou reçu, reconnaissent un soulagement, un mieux être, une libération. Déchargés d’un sac à dos trop lourd, leur marche est redevenue dynamique.
Mais attention, le pardon ne s’impose pas facilement à notre esprit. Il est le résultat d’une longue réflexion sur soi. C’est l’apprentissage d’un processus de libération. Car, disons le d’emblée, pratiquer le pardon, c’est d’abord se libérer soi-même. Mais, on peut sincèrement désirer l’expérimenter, sans pour autant parvenir à le réaliser. C’est bien là toute la difficulté !
Comme il y a autant de pardons que d’agresseurs et de victimes, essayons de pointer les différentes étapes qui peuvent nous conduire au vrai pardon. Pour cela, tentons de mettre en correspondance les travaux de deux psychanalystes, Nicole Fabre et Gabrielle Rubin, avec le Nouveau Testament.
1) Reconnaître la réalité de l’agression :
Dans le contexte de résolutions de problèmes, le premier réflexe est de définir précisément quel est le problème. Méfions-nous de ce qui peut paraître clair. La question des évidences est souvent piégée. Il vaut mieux reformuler les faits plusieurs fois, que de se méprendre sur le diagnostic. Cela dit, il est évident que la situation est différente, suivant que l’on est agresseur ou agressé.
En tant qu’agresseur dans notre relation à Dieu, la Bible pose un diagnostic avec un mot précis : le péché. Dépouillé de tout poids de culpabilité, ce mot exprime une rupture de contrat relationnel avec notre Père céleste. De ce fait, c’est quand on se reconnaît pécheur (acte lié à la repentance) que le pardon de Dieu devient opérationnel (cf. Romains 2 : 4).
Dans la relation au prochain, la plupart du temps notre douleur provient d’une agression (qu’elle soit mineure ou majeure). Il s’agit donc de déterminer ce qui, en soi, a été agressé : Notre corps ? Notre orgueil ? Notre amour-propre ? Notre honneur ? Là commence la difficulté.
Devant la gageure à mettre le pardon en action, le premier réflexe est de chercher à oublier l’offense. On voudrait pouvoir gommer le passé. C’est une démarche iconoclaste. Les psys disent qu’à ce moment là, souvent un mécanisme de défense enfouit la souffrance, la haine et la rancœur quelque part dans l’inconscient. Malheureusement et heureusement, nous ne pouvons pas oublier. Entretenir la mémoire des faits alimente, soit un mécanisme de défense qui ravive la souffrance destructrice (plus qu’il ne l’apaise), soit renforce la crédibilité du pardon.
La première bonne réaction est de reconnaître les faits et de renvoyer à l’agresseur son agression. Quelques soient les circonstances, l’action subie est à dénoncer. Il ne faut surtout pas se taire !
Le Christ, lors de son procès à Jérusalem, devant le souverain sacrificateur, a été giflé par un huissier de service. La raison invoquée était : avoir manqué de respect au souverain sacrificateur. Comment le Christ a-t-il réagi ? Qu’a-t-il dit à cet huissier de service ?
« Jésus lui dit : Si j’ai mal parlé, explique-moi ce que j’ai dit de mal ; et si j’ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu ? » Jean 18 : 22-23.
Retourner l’agression à son agresseur, c’est non seulement se respecter soi-même, mais encore donner à l’autre l’occasion de prendre conscience de son agression. Certains parlent de renouer avec soi-même, afin de ne pas sombrer dans une maladie psychosomatique.
2) Décider de ne plus souffrir :
Rompre avec la vengeance, le ressentiment profond, l’amertume et tous les cortèges d’aigreur n’est pas chose facile. Paradoxalement, pour entamer un processus de guérison, il faut faire sortir le mal qui est en soi. On peut même l’exprimer avec colère, voire avec haine. Il est normal, dans un premier temps, que la victime exprime fort sa souffrance, car c’est déjà la reconnaître et la faire reconnaître. Les professionnels insistent sur le fait que l’on ne peut pas faire taire sa haine. Si on ne la canalise pas vers l’agresseur, c’est vers soi qu’elle se dirige. On s’autodétruit. Mais, dans bien des cas, il est impossible d’exprimer cette haine contre son agresseur (surtout si c’est un parent ou un être profondément aimé). Que faire alors ? Il peut être salutaire, après l’avoir exprimé verbalement à sa façon, de coucher cette haine sur une feuille de papier ou de trouver un autre moyen pour qu’elle sorte. On peut se confier à un ami, ou si l’on est croyant s’adresser à Dieu. Plusieurs exemples sont mentionnés dans la Bible. Job (Job 6), Moïse (Exode 17 :1-7), David (Psaume 141), Jonas (Jonas 4). Ils ont tous exprimé leurs sentiments d’incompréhension et de colère. Dieu a toujours accueilli, sans pour autant effacer les conséquences de leurs actes. Mais, en définitive la confiance a été rétablie. Or, elle sous-tend la notion de pardon. Dans les cas que nous venons de citer, que serait devenue leur marche avec Dieu, s’ils n’avaient pu exprimer fortement leurs ressentis ?
N’est-ce pas aussi la possibilité de contester qui féconde la confiance ?
Décider de ne plus souffrir, c’est prendre la décision d’inverser le cours de son histoire, afin de ne pas se laisser envahir par le mal récurent du non-pardon.
3) Cesser de se sentir coupable ; se savoir pardonner, savoir se pardonner :
Si l’on n’a pas complètement évacué ses ressentiments négatifs, il se passe souvent quelque chose d’étrange. On finit par croire que c’est de notre faute. Dans le cas des agressions physiques, souvent les victimes arrivent à se sentir coupables. Coupables de ne pas avoir résister, coupables d’être passer là au mauvais moment, coupables d’avoir fait le choix d’aller à tel endroit etc.
Sur le plan spirituel, on peut tout autant se détruire en n’arrivant pas à se pardonner. La culpabilisation s’installe. Elle est tenace et perverse. Elle masque l’amour de Dieu et nous fait douter de sa bonté envers nous. Et pourtant, le fait de reconnaître la vraie nature de notre situation (de pécheur), ne devrait pas occulter l’autre réalité : se savoir pardonner en Jésus-Christ pour toute erreur ou faute reconnue. Cette prise de conscience est libératrice.
La trahison de Pierre est éclairante sur ce point. Malgré l’intimité de relation qui unissait Jésus et l’apôtre Pierre, ce dernier va le trahir à un moment crucial. Par trois fois Pierre renie son Seigneur et Maître. En conséquence « il pleura amèrement » Luc 22 : 62, version LSG. Imaginons les remords, les regrets, les demandes fortes de pardon qui sont montées vers Dieu ! Le temps passe… Puis vient le moment où les femmes viennent annoncer la résurrection du Seigneur. Les disciples doutent. Pierre et Jean se lèvent promptement et ils trouvent le tombeau vide. Surtout pour Pierre, toujours tenaillé par le remord, tout s’écroule. Il est dans la confusion la plus totale. Pourtant, en réalité, il n’est pas oublié, mais il l’ignore. Sa détresse quelque part est prise en compte. Mais le temps passe, et c’est seulement lors de sa troisième apparition, que Jésus donne à Pierre l’opportunité de réaffirmer son amour pour lui. Pierre découvre enfin le bonheur de se savoir pardonner (cf. Luc 24 : 12 ; Jean 21 : 15-17).
S’il est bienfaisant de se savoir pardonner, il est tout aussi important de savoir se pardonner. Pourquoi est-ce essentiel de faire cette démarche ? Pourquoi avons-nous tant de mal à nous donner le droit à l’erreur ? Avons-nous la capacité de vivre toujours le bien, le bon, le parfait ? Devant la femme adultère, Jésus a dit :
« Que celui d’entre vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle » Jean 8 : 7, version LSG.
L’apôtre Paul répond aussi au travers de son expérience :
« J’ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas… Misérable que je suis ! Qui me délivrera de ce corps de mort ? Grâces soient rendues à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur ! » Romains 7 : 18-19,24-25, version LSG.
La culpabilité qui consiste à nous maintenir la tête sous l’eau est l’œuvre du malin. De plus, nous ne sommes pas totalement responsables de tout ce qui nous arrive !
Personne n’a demandé à subir les conséquences de la faute d’Adam et Eve ! Arrêtons de nous sentir toujours coupables ! D’un autre côté, ne prenons pas non plus ce prétexte pour faire tout et n’importe quoi. Engageons, comme l’apôtre Paul, notre responsabilité. Reconnaissons les travers de notre véritable nature. Présentons-les simplement au Seigneur. Dieu nous pardonne à travers son Fils et nous réconcilie avec lui, en vue d’une relation éternelle (cf. Romains 5 : 10 ; 2 Corinthiens 5 : 18-20 ; Colossiens 1 : 21-23).
Bien que l’idéal que Dieu nous propose soit très élevé, voire inaccessible sans son aide, il nous appartient de nous détacher de ce « moi idéal » hérité de la culture judéo-chrétienne. Arrêtons de croire que la perfection est possible ! Arrêtons de dire : « je suis impardonnable d’avoir commis tel acte, ou d’avoir agi de cette façon ». Cessons de nous sentir coupables, donnons-nous le droit à l’erreur. Se pardonner d’abord à soi-même est essentiel dans le processus d’accueil du pardon de Dieu.
4) Comprendre celui ou celle qui nous a agressé :
La haine, la colère, le vif ressentiment, toutes les pensées négatives à l’encontre de l’agresseur doivent s’exprimer ponctuellement. Il y a nécessité à les « faire sortir », seulement on ne peut en rester là. Ce soulagement a une durée de vie limitée. Tout n’est pas résolu pour autant dans le temps. Au contraire, le fait d’en prendre conscience augmente même notre souffrance. Une des pistes qui apporte un soulagement plus durable consiste à chercher à comprendre son agresseur. Comme le dit le philosophe français Paul Ricœur : « il est important de ne pas limiter un homme à ses actes, aussi monstrueux soient-ils ». Cette démarche de compréhension n’a rien de commun avec le fait d’excuser l’agression. Chercher à comprendre, c’est se situer sur un même plan d’humanité. C’est dans ce sens qu’il faut entendre les paroles du Christ : « Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent… » Matthieu 5 : 44, version LSG.
Répondant aux questions de Simon Wiesenthal concernant les atrocités des camps de concentration, Simone Veil émet l’idée qu’accorder le pardon, c’est se prouver à soi-même que l’on a conservé un peu d’humanité. J’ai personnellement ressenti ce sentiment pendant la guerre d’Algérie, lorsqu’un 24 Janvier 1960, mon père a été mortellement blessé par le tir d’un C.R.S, alors qu’il venait porter secours à un homme blessé devant une barricade, à Alger. Comment peut-on tirer sur un homme sans arme, alors qu’il porte secours à un autre homme blessé ? comment faire un carton comme on tire un lapin en pleine campagne ?
Chercher à comprendre m’a aidé, non à excuser l’acte en lui-même, mais à mieux intégrer la misère de tous les humains que nous sommes. Misère qui nous conduit à nous entredéchirer dans des rapports de force, plutôt que de construire des liens d’humanité.
Nicole Fabre relate (dans son livre « les paradoxes du pardon » p. 135) le souvenir que Simon Wiesenthal raconte dans son livre les fleurs du soleil. Alors qu’il était interné dans un camp de travail durant la seconde guerre mondiale, il fut conduit au chevet d’un officier allemand mourant. Cet officier nazi voulait confier ses crimes à un juif pour obtenir son pardon et partir en paix. Simon Wiesenthal l’a écouté attentivement en silence, puis s’est levé sans rien dire et a quitté le mourant. Cette rencontre l’a emmené à s’interroger… Aussi, à la fin de la guerre, il a décidé de retrouver la maman de ce nazi et a voulu la rencontrer. Ils ont parlé de ce fils, mais Simon Wiesenthal n’a pas eu la force de lui révéler les atrocités commises par son fils. A défaut de pardon, Simon Wiesenthal a effectué un geste d’apaisement. Il est allé au-delà du pardon ordinaire. Il a vécu un lien d’humanité. Il a renoué avec l’humanité. Cette démarche est d’essence spirituelle, elle en dit plus que des mots…
Prendre conscience des bassesses de notre humanité, c’est assumer ses limites, ses faiblesses, ses misères. Notre toute petite planète bleue, n’est-elle pas infiniment petite devant l’univers infini ? Sa beauté contraste avec notre misère humaine !
La bible confirme cette piste de réflexion :
« Sentez votre misère… Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera » Jacques 4 : 9-10, version LSG.
Dieu rappelle à Moïse qu’il a donné à l’homme : « un cœur pour comprendre, des yeux pour voir, des oreilles pour entendre » Deutéronome 29 : 4, version LSG.
Laisser du temps au temps :
L’Ecclésiaste disait déjà : « Il y a un moment pour tout, un temps pour chaque chose dans le ciel ». Ecclésiaste 3 : 1, version LSG.
Le temps est un allié précieux dans la démarche de mise en place du pardon. Pardonner ce n’est pas tout effacer d’un geste magnanime… Ce n’est guère davantage passer l’éponge ou dire : « On n’en parle plus ». Ce type de pardon, non seulement ne résout rien, mais plus encore, complique le processus de guérison. Comme sur le plan physiologique une plaie prend du temps à cicatriser, de même, pour vivre la libération d’un vrai pardon, il est nécessaire de prendre son temps.
Un pardon trop vite accordé peut être perçu, inconsciemment, comme une invitation à reproduire, sans gène, le méfait. Il ne permet pas à l’agresseur de se remettre en question. Paradoxalement, ce genre de pardon accordé à bon marché risque même de se retourner contre celui qui en a pris l’initiative. En renforçant la position de l’agresseur, en lui donnant un blanc seing, la relation agresseur-agressé devient inextricable. Donner du temps au temps, c’est, dans certaines circonstances, avoir la sagesse de laisser mûrir l’abcès pour pouvoir ensuite le vider totalement. Dans d’autres, c’est laisser passer le temps de la colère, pour être plus lucide sur les faits. Dans d’autres encore, c’est attendre de saisir une opportunité pour amorcer un nouveau dialogue. Le temps a cette qualité de nous apprendre à relativiser les agressions, à réfléchir sur soi, à se poser les bonnes questions, à mieux appréhender l’avenir en vue d’une saine relation. Mais il ne faut pas se leurrer, la route du vrai pardon peut être longue, semée de rebondissements. Dans certains cas, son issue est même incertaine, car il faut être deux, au moins, dans le processus du pardon. Si la justice humaine accorde un délai assez long de prescription pour juger (c'est-à-dire réviser éventuellement de nouveaux éléments passés sous silence), c’est bien parce qu’elle a pointé l’importance du facteur temps. Sur un plan spirituel, il n’y a jamais prescription. Seule la pratique authentique du pardon libère. Mais, comme dans le domaine physique une blessure profonde laisse toujours une cicatrice, de même dans les relations humaines, les cicatrices ont valeur de rappel. Car l’oubli n’est ni possible, ni souhaitable. Il a une signification pédagogique importante. Se donner du temps peut se révéler un choix nécessaire pour se protéger. Prendre de la distance avec l’agresseur pour se sauvegarder fait partie de nos décisions. Elle intègre les bienfaits du temps. Pardonner est dans un premier temps, décider de ne pas rendre le mal subi, de s’en écarter, de prendre de la distance. Il faut parfois reprendre sa liberté, pour retrouver sa sérénité, et être mieux à même d’affronter la réalité qui nous blesse.
L’urgence est de prendre soin de soi. Se donner un espace de liberté pour se recentrer sur soi. Refuser ce qui détruit pour se repositionner vers ce qui nous construit et nous élève. Cette décision est un des temps forts du processus du pardon. Le temps a donc bien une valeur pédagogique. Toutefois, il ne faut pas oublier de commencer par se pardonner. Sinon, comment accorder le pardon, ou même recevoir le pardon de Dieu, si on ne se pardonne pas à soi même ? Se donner le droit à l’erreur n’est point une autorisation à pratiquer le mal. C’est reconnaître que les choix sont difficiles. Il arrive parfois que l’on soit devant un choix de moindre mal. Entre deux maux, il faut choisir celui qui a le moins de conséquences négatives. Mais on est conscient que ce n’est pas le bon choix. Sans compter que l’influence du mal s’insinue partout. Il distille la confusion et complexifie nos choix. Se culpabiliser, c’est alors entrer dans le jeu de l’ennemi.
Devant cette difficulté, il ne s’agit pas seulement d’égrener des solutions, il nous faut aussi un repère fiable. Celui du Seigneur Jésus peut nous aider : « Pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi » Colossiens 3 : 13, version LSG. L’injonction du Seigneur nous fait prendre conscience qu’il faut d’abord partir de soi pour accueillir le pardon, puis ensuite celui qui vient de Dieu. Ce n’est qu’après que nous pouvons nous tourner vers l’autre, mon frère ou ma sœur.
5) Les écueils au pardon :
Répétons-le, le pardon n’est pas oubli. Les faits relèvent de notre histoire. Non seulement le pardon n’est pas l’oubli, mais plus encore le souvenir est nécessaire pour donner de la profondeur au pardon.
Le pardon ne se confond pas avec l’excuse, ni avec la preuve d’une autojustification. Il va sans dire que nous ne parlons pas ici de la simple broutille, mais d’un acte agressif important. L’excuser serait de banaliser les faits, les minorer. De ce fait l’agresseur ne pourrait les reconnaître comme importants. Les approuver encore moins, même si on peut toujours trouver des circonstances atténuantes. Justifier relève de la justice. Le droit dira ce qui relève d’une transgression de la loi et d’une condamnation.
Le pardon n’est pas une démission de ses droits. Le pardon ne supprime pas la justice. Chacun doit assumer les conséquences de ses actes.
Le pardon n’est pas un devoir, pas plus une obligation chrétienne. On ne peut se forcer à pardonner. La motivation intérieure est cardinale dans la démarche. La sincérité fait partie des critères qui favoriseront la guérison. Le pardon n’est pas un geste de supériorité. « Je suis meilleur que toi… C’est le plus intelligent qui pardonne etc. »
Le pardon est avant tout une démarche du cœur. C’est la motivation première qui mobilise la volonté.
Le pardon n’est pas le refoulement de ses sentiments. Je pardonne, mais du bout des lèvres, parce qu’il le faut bien, ou parce que l’on m’a appris à le pratiquer. Mais à la première occasion, « je dégaine » … On ne met pas un emplâtre sur une jambe de bois !
Le pardon n’est pas un acte héroïque. C’est toujours gratifiant d’accorder le pardon. Cette manifestation altruiste peut masquer des motivations malsaines. Pour vivre un vrai pardon, on a besoin d’un accompagnement. Pour les chrétiens, l’esprit de Dieu-le Père, l’aide du Saint-Esprit, l’accompagnement du Christ, l’assistance des anges sont très appréciables.
Le pardon n’est pas synonyme, ipso facto, de réconciliation. Le pardon procède d’une démarche intérieure, la réconciliation est la manifestation extérieure du pardon. C’est une suite certes naturelle, mais elle n’est pas systématique.
Le refus d’ignorer que notre réelle souffrance peut aussi être en synergie avec notre jugement erroné peut aussi parasiter le processus du pardon.
6) Les options d’un non-pardon :
Le refus d’envisager la mise en pratique du pardon n’est pas anodin. Cette attitude réduit le champ des conséquences heureuses. Si on veut camper sur la position du non-pardon que nous reste-t-il comme alternatives ?
- La vengeance active : C’est la volonté de rendre le mal. Œil pour œil, c’est la loi du talion.
« S’il y a un accident, tu donneras vie pour vie, œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied, brûlure pour brûlure, meurtrissure pour meurtrissure… » Exode 21 : 23-24, version LSG.
- La vengeance passive : c’est retourner le mal vers soi. Cela est décliné par des effets pervers très variés. Ils sont le fond de commerce des psychologues. Il s’agit du repli sur soi, du refus de se donner les moyens d’être heureux. Lasser de subir, on s’agresse et on agresse son entourage. Les repères de ce mal être se manifestent par l’aigreur, la vision négative sur tout, la critique de tout sur tout, etc.
- Le refus de vivre le présent positivement :
Les personnes sont obsédées par les faits du passé. Elles vivent comme par procuration. Elles rendent le présent insupportable et n’envisage pas le futur avec joie. Leur vie est comme gangrenée par un mal rongeur. Elles ont une difficulté à progresser. Elles sont bloquées et ne peuvent surmonter l’agression passée, la blessure, la trahison… Dans leur conversation, d’une manière récurrente, elles reviennent et ressassent les mêmes douleurs. A force de ruminer, elles abîment par la souffrance, ce qui est le plus précieux dans la vie : le bonheur d’aimer. Souvent, ne comprenant pas la vraie nature du pardon libérateur, elles se confortent dans une position de non-pardon, perçue comme un acte de faiblesse. Elles cultivent le ressentiment (re-sentir= sentir 2 fois).
A chacun de choisir sa piste de réflexion… Notre intention n’est nullement de pointer tous les écueils du non-pardon. Ils sont complexes et éminemment variés. Notre responsabilité individuelle nous incite à procéder à l’inventaire de nos réelles difficultés… La lucidité sur soi est un atout dans sa vie.
7) Le pardon, un acte libérateur :
Quelque soit la douleur ou la violence de l’agression subie, le pardon accordé renouvelle en nous un espace de liberté. On respire mieux, on se projette mieux, on marche mieux. On est comme déchargé d’un poids énorme.
Le vrai pardon génère la paix. On se libère et on libère autrui. Pardonner, c’est renouer avec celui qui nous a fait mal, c’est progressivement rétablir un lien, et finalement lui renouveler notre confiance. Cette évolution, pour ne pas dire révolution, est étrangère à notre nature humaine. Sans une grâce elle est impossible à vivre. J’ai reçu le témoignage d’une amie. Elle écrivait : « Pardonner est un miracle que Dieu opère dans nos vies. On m’a souvent dit que je ne me rendais pas compte qu’il y avait des choses impardonnables. Ces personnes ne réalisent pas la puissance de Dieu dans nos vies ».
Le message et la vie de Christ démontrent cette puissance. Ils apportent un éclairage magnifique sur le pardon donné ou reçu.
Comme pour l’amour, le Seigneur est venu redonner au mot pardon un sens plus précis, plus profond. Si effectivement le Seigneur a dit : « Tu aimeras ton prochain comme toi-même » on peut tout aussi bien énoncer l’équation suivante : « Tu pardonneras ton prochain comme tu te pardonnes à toi-même ». La puissance de la grâce a transformé la vengeance de Caïn et de Lémec (cf.77x7 ; Genèse 4 : 23-24) en pardon sans frontière (cf.77x7 ; Matthieu 18 : 22).
Dans un premier temps, il est important de se recentrer sur soi. J’aime cette expression biblique d’être en veille. En veille dans sa vie, avant de vouloir l’être dans la vie des autres, même dans celle de nos proches. Le Seigneur dira : « Prenez garde, veillez et priez » Marc 13 : 33. L’apôtre Paul recommande à son disciple Timothée : « Veille sur toi-même et sur ton enseignement » 1 Timothée 4 : 16, version LSG.
Veillez sur soi- même, mais pour quoi faire ?
- Pour être en paix avec soi-même et avec les autres. « Recherchez la paix avec tous… Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu ; à ce qu’aucune racine d’amertume, poussant des rejetons, ne produise du trouble, et que plusieurs n’en soient infectés ; » Hébreux 12 : 14-15, version LSG.
- Pour être bienveillant avec soi-même :
« Si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur, et il connaît toutes choses » 1 Jean 3 : 20, version LSG.
Avant d’examiner nos difficultés de relation vis-à-vis d’autrui, la Bible nous parle de notre relation personnelle avec l’auteur de notre vie, Dieu le créateur.
Le Christ est venu pour redonner sens à cette relation, et le pardon occupe une place prépondérante dans ses messages. Cette affirmation est soutenue par la prédication vécue de notre Seigneur Jésus-Christ. Elle était même prophétiquement annoncée. Jean le Baptiste, préparant la venue du Christ, annonce au peuple la connaissance du salut par une libération. (cf. Luc 1 : 77). Le Christ lui-même, dès le début de son ministère, annonce la délivrance (cf. Luc 4 : 18). Après avoir pratiqué le pardon des péchés (cf. Matthieu 9 : 2,5 ; Luc 7 : 48 ; Jean 20 : 23), le Seigneur missionna ses apôtres pour continuer à propager cet enseignement (cf. Luc 24 : 46-47). A la Pentecôte, l’apôtre Pierre déclare : « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés » Actes 2 : 38, version LSG. L’apôtre Paul agira de même devant le roi Agrippa (cf. Actes 26 :18). Il affirmera aux juifs de la synagogue d’Antioche : « Sachez donc, hommes frères, que c’est par Jésus que le pardon des péchés vous est annoncé » Actes 13 : 38 (cf. Colossiens 1 : 14).
Il y a bien une démarche personnelle à vivre. Aucune faute, si grave soit-elle, ne peut nous empêcher de recevoir le pardon de Dieu. L’apôtre Pierre dira au centurion Corneille : « Quiconque met sa foi en Jésus-Christ reçoit par son nom le pardon des péchés » Actes 10 : 43.
Pourquoi cette démarche est-elle si importante ?
Parce qu’acter le fait que nous pouvons être pardonnés a des répercussions dans notre vécu. L’affirmation : « on ne peut donner que ce que l’on a reçu » a là toute sa place. Quiconque n’à pas conscience d’avoir reçu (accueillir le fait d’être pardonné) sera en difficulté de relation, un jour ou l’autre. Voilà pourquoi la référence à la vie de Christ est instructive. Elle nous apprend quelque chose de fondamental : Le pardon est avant tout un don de Dieu. L’humain par nature sera plus prompt à la vengeance qu’au pardon. C’est une réalité que l’on peut acter facilement dans l’histoire ancienne et contemporaine.
Pour que le pardon naisse comme un désir du cœur, une aide extérieure est nécessaire. Cela bien sûr peut être le travail d’un professionnel. Mais il me semble que le message du Christ apporte un plus, à tous ceux et celles qui veulent bien approfondir la notion de pardon.
A cette fin, il nous faut au préalable accepter un constat : Nous ne savons pas pardonner. Une fois posée cette affirmation, il faut pouvoir trouver un remède. Une des pistes consiste à prendre conscience du pardon de Dieu dans nos vies. Quand on se sent pardonner, il est plus facile de reproduire ce bienfait.
Or, la Bible nous affirme que le pardon est un don de Dieu, indépendamment de tout mérite. Il y a le pardon collectif et le pardon individuel. Ne nous attardons pas sur le premier. Citons simplement ce passage : « Dieu l’a élevé (Jésus-Christ) par sa droite comme pionnier et sauveur, pour donner à Israël un changement radical et le pardon des péchés » Actes 5 : 31, version N.B.S.
Pour le pardon individuel, faisons référence, tout aussi simplement, au repas de communion, la cène (ou repas eucharistique). Chaque participant entend, à cette occasion solennelle, lors de la présentation de la coupe, les paroles de Jésus :
« Ceci est mon sang, le sang de l’alliance, qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés » Matthieu 26 : 28, version LSG. Reformulant ce qu’il avait reçu du Seigneur à propos de la Cène, l’apôtre Paul précise : « Que chacun s’éprouve soi-même, et qu’ainsi il mange du pain et boive la coupe » 1 Corinthiens 11 : 28, version LSG.
Il y a donc bien une démarche personnelle d’accueil du pardon de Dieu. L’apôtre Paul le rappellera à chaque membre de la communauté d’Ephèse : « En lui (J.C.) nous avons la rédemption par son sang, le pardon des fautes selon la richesse de sa grâce » Ephésiens 1 : 7, version LSG.
Ainsi, bibliquement, le pardon est don. C’est par le don que l’on comprend le pardon.
Mais à quoi, cette prise de conscience peut-elle bien servir, si on ne pratique pas le pardon pour autrui ?
A cet endroit, redisons que le pardon est plus une bonne disposition du cœur, qu’un acte banal de volonté. Un jour, l’apôtre Pierre s’est approché du Christ et lui a posé la question suivante : « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère, lorsqu’il péchera contre moi ? Sera-ce jusqu’à sept fois ? Jésus lui dit : Je ne te dis pas jusqu’à sept fois, mais jusqu’à soixante-dix fois sept fois » Matthieu 18 : 21-22, version LSG.
Pierre a cru être généreux en proposant 7 fois, mais le Seigneur a démultiplié sa proposition : 70x7=490 fois. Pour le citoyen lambda, ce chiffre de 490, renvoie au caractère infini de la notion du pardon. Mais, pour un juif connaisseur des rouleaux des prophètes, il rappelle la prophétie de Daniel 9 (prophétie des 70 semaines ou 490 jours). Suivant le principe d’interprétation d’Ezéchiel, 1 jour= 1 année (Cf. Ezéchiel 4 :6), cette prophétie part de la reconstruction des murs de Jérusalem sous Néhémie (457 av. J.C.) pour aboutir à la mort du Christ, puis à la naissance du christianisme en 33). Pour simplifier, disons que ce chiffre ravive pour le croyant la mémoire d’une période de restauration matérielle et spirituelle (au retour de l’exil). Elle nous conduit à la restauration spirituelle complète, par la victoire du Christ sur la croix. Elle ouvre d’une ère nouvelle pour l’humanité. Cette prophétie nous parle de l’amour de Dieu pour l’homme. Elle lui propose une solution définitive, car la victoire du Christ sur la mort devient aussi par la foi notre victoire (cf. Romains 6 : 3-8)
Ainsi, si nous comprenons que le pardon est vraiment don, comment dès lors refuser à autrui ce que Dieu nous a déjà accordé ?
Que nous soyons agresseur ou agressé, la demande de pardon est un acte libérateur. Mais, pour que la cicatrisation de nos blessures soit effective, il est indispensable que cette demande soit ressentie et identifiée comme vraie par la victime. En cela, le facteur temps est important. La route peut être longue, d’autant qu’il n’est pas question d’oublier, puisque les cicatrices sont toujours là.
Résumons : Dans un cheminement vers un vrai pardon libérateur, il est important de prendre conscience du facteur temps. Il est recommandé de faire l’inventaire des difficultés qui nous bloquent dans la progression vers un vrai pardon. Si nous voulons camper sur nos positions et refuser le pardon pour soi et pour autrui, il vaut mieux être au clair sur les conséquences tant psychiques, morales, spirituelles et physiques.
Par contre, décider de prendre la route du pardon, c’est conduire sa vie vers une destination heureuse, libre, jalonnée de bonnes surprises.
Nous allons aborder la dernière partie de notre étude. Rappelons que notre objectif est de proposer des « légumes de vie » afin que chacun puisse faire son marché à sa convenance. Devant l’étendue du sujet et sa complexité, nous ne faisons qu’esquisser à grands traits quelques éléments de réflexion… humblement, notre souhait est de progresser ensemble dans l’apprentissage du mieux vivre un vrai pardon. Notre référence biblique nous a aidés à définir le sens des mots. La psychanalyse nous a permis de pointer des passages obligés… Nous avons donc déjà examiné les points suivants :
- La reconnaissance objective de l’agression subie.
- L’importance de la décision de ne plus vouloir souffrir.
- Cesser de se sentir coupable, se savoir pardonner, et savoir se pardonner.
- Chercher à comprendre les motivations de notre agresseur.
- Laisser du temps au temps.
- Les écueils au vrai pardon.
- Les autres options du non-pardon…
Nous avons ensuite développé l’importance de l’acte libérateur du pardon. Poursuivons en soulignant d’autres facteurs complémentaires.
8) Le travail des historiens et de la justice :
Les faits de notre agression, comme toutes les autres agressions, s’inscrivent dans une histoire dont il convient de garder le souvenir. Il en va de même sur un plan collectif avec les guerres, les génocides etc. Le rôle des historiens et de la justice devient prépondérant.
En préambule, constatons que l’histoire récente du 20è siècle met à mal la notion du pardon. Les 2 guerres de la France en Europe, la guerre d’Algérie, les atrocités des pays totalitaires, les génocides, toutes ces atrocités mettent en constat d’échec la force du pardon. Pardonner n’est pas : oublier. Il faut faire mémoire. Voilà pourquoi le rôle des historiens est incontournable. Dans ces cas, il s’agir d’honorer ceux qui nous ont quittés. La transmission est nécessaire, paradoxalement, elle contribue à la cicatrisation des blessures de nos cœurs. Je l’ai personnellement expérimentée avec le meurtre de mon père en Algérie. Le pardon est aussi se souvenir ensemble (d’où les commémorations) pour se rapprocher, se réconcilier et renouer avec la fraternité.
Les situations qui relèvent d’actes sadiques, vis-à-vis d’enfants ou de femmes, sont tout aussi complexes à gérer. Il est important que la justice dise le droit et rapporte la vérité des faits. Souvent dans ces circonstances, le pardon est reconnu comme impossible. Mais, c’est précisément là qu’il est bien nécessaire. Nicole Fabre à la fin de son livre déclare : « à littéralement parler on ne pardonne que de l’impardonnable. On pardonne parce que justement c’est impardonnable et que seul le pardon permet de relancer l’histoire et de reconstruire le monde malgré la catastrophe. Mais si l’on ne peut parler de pardon que face à l’impardonnable…vers quels autres horizons sommes-nous conduits » Op., déjà cité, p.146.
On constate assez vite que le parcours du pardon nous conduit sur des chemins que nous n’aurions jamais empruntés… Il est vrai qu’il faut être deux pour pardonner. Mais là encore, même si le sentier est étroit et difficile, il faut aussi penser à soi. Il faut se remettre en dynamique de vie. Le pardon ne va pas à l’encontre d’une décision de justice. Bien au contraire, la peine encourue dit que l’agression (donc la douleur de l’agressé) a été reconnue.
C’est un élément à prendre en compte dans la marche vers le vrai pardon.
9) Reprendre le contrôle de sa vie :
La vie est trop courte pour se laisser gangrener par des sentiments corrosifs. Il est bienfaisant de reprendre le contrôle de sa vie en progressant dans la pratique du pardon. Non seulement le pardon cicatrise les plaies stockées dans la mémoire, mais de surcroît, il nous transfuse une énergie nouvelle. Il nous déconnecte de tout réflexe oblatif…
Maintenant, comment savoir si nous avons vraiment pardonné ?
En ressentant physiquement les bienfaits de cette libération. Elle concerne non seulement notre esprit, mais aussi notre cœur. Le pardon est un acte libérateur qui dissout la douleur avec le temps, au point de ne plus la rendre perceptible.
Concrètement, cela nous conduit à revisiter nos niveaux d’exigences dans notre relation à autrui. Un repositionnement dans notre relation à Dieu s’opère tout aussi naturellement. Alors, on découvre avec émerveillement, qu’avant d’être notre fait, le pardon est don de Dieu. C’est par le don (par-don) de Dieu que s’ouvre la porte du vrai pardon ! Ainsi l’impardonnable devient possible, justement parce qu’il est impardonnable.
Les évènements de la vie nous placent en situation de réflexions. On a besoin de découvrir la vérité sur soi. Le pardon, paradoxalement est lié à la vérité sur soi et sur autrui. Le pardon s’inscrit donc dans une recherche de vérité. Il s’agit de décider de se frayer un chemin pour se sentir bien avec soi- même. Dès lors, la relation à autrui est facilitée…
Découvrir au travers de chaque humain un frère d’humanité, voilà vers quoi la notion de pardon nous dirige. C’est un défi considérable pour nous qui sommes engoncés dans le jugement concernant les races, les cultures, les religions, les fratries, les amis, les voisins etc…
Le pardon, dans la Bible, est présenté comme une redécouverte, un renouvellement d’attention. Il nous renvoie au projet initial de Dieu, notre Père. Quel est ce projet ? C’est avant tout un projet d’Amour. Cet amour développe l’estime de soi, la tolérance, l’absence de jugement, le respect, l’humilité, la solidarité de la condition humaine.
Pardonner, c’est grandir. C’est un précipité « chimio-spirituel » de l’amour. Car le pardon transforme, surmonte tout parasitage de relation, éveille à la reconstruction du possible, nous ouvre à la vraie liberté. Et comme le dit Nicole Fabre, à la conclusion de son livre : « Et peut-être au champ illimité du spirituel » p. 165. Même si le sens du mot « spirituel » peut être entendu dans son sens large, c’est aussi notre conviction.
Pardonner, en définitive, n’est rien de moins que renouer avec l’amour de la vie.
Redevenir acteur de sa vie, c’est prendre cette direction et faire le premier pas. L’accompagnement de Dieu nous permet d’aller même au-delà du pardon. La capacité de pardonner finit par se conjuguer avec le verbe aimer…
10) L’après-pardon :
Comment savoir si l’on a vraiment pardonné ?
Il n’y a pas de test fiable déterminant la réalité du pardon. Par contre, celui ou celle qui est concerné ressentira des bienfaits concrets : une impression de légèreté. Un soulagement notoire. Une libération pouvant être pointée, même dans son corps. Une envie d’entreprendre, de passer à autre chose. La pratique du pardon revitalise le corps et l’esprit. Un regain d’énergie s’éveille. Il guérit la souffrance présente ou passée. Il met en évidence les disfonctionnements de nos appréciations sur autrui, les côtés erronés de nos jugements rapides, une envie de revisiter « nos exigences ».
Comment savoir si nous avons vraiment pardonné ? Gabrielle Rubin écrit « lorsque tout sentiment de culpabilité pour ce qui s’est passé a disparu ». Cela laisse entendre que l’on ne ressent plus ni colère, ni rancœur à l’encontre de celui qui nous a fait souffrir. Pour Nicole Fabre, le point de repère est « le passage à l’acte, qui conduit au retour de sa mobilité dans sa vie ». Elle fait référence au pouvoir libérateur du pardon. La douleur se dissout. Elle permet à l’offensé ou l’agressé de redevenir acteur de sa vie.
Le pardon entraîne donc en conséquence une modification dans nos rapports au prochain. Nos critères d’appréciations évoluent. On se sent grandir…
Pardonner, c’est vivre le plan de Dieu et imiter même imparfaitement l’exemple du Christ : c’est revisiter le sens de sa présence au cœur des humains. Le pardon est en correspondance avec la découverte d’une vérité sur soi. Pour nous chrétiens, le point de référence est le Christ. En nous repositionnant dans une relation de confiance, on referme petit à petit nos plaies émotionnelles. L’acte de foi qui prend au mot la parole du Christ : « je suis avec vous tous les jours, jusqu’à la fin du monde » Matthieu 28 : 20,version LSG, ouvre de nouvelles perspectives sur soi et sur la relation à autrui.
Le pardon est une merveilleuse opportunité pour redécouvrir l’amour de Dieu. Il nous projette dans une réévaluation de nos fonctionnements. Concrètement on compte parmi les bienfaits de la pratique du pardon : l’absence de jugement, une progression dans l’humilité, une indulgence sans complaisance sur soi et sur autrui, une plus grande compassion vis-à-vis de la condition humaine.
Sur un plan spirituel, pardonner est une alchimie avec la foi, l’espérance et l’amour (cf.1 Corinthiens 13 : 13). Cette force qui nous ouvre à l’autre, notre frère, est mystérieuse. Elle procède d’une transfusion de l’amour de Dieu dans nos vies.
Conclusion : la pratique du pardon est l’expérience qui nous ouvre à la vie heureuse.
11) Essai de proposition d’un protocole dans l’élaboration du pardon :
Nous avons énoncé la vérité que le pardon cicatrise la mémoire. Ce pouvoir de guérison est réel. Ce n’est pas pour autant qu’il est remplacé par l’oubli ! Bien au contraire, le souvenir est essentiel, il agit comme la piqûre de rappel d’un vaccin pour une bonne protection contre l’agression éventuelle de virus. Nos vies portent les traces de ces marqueurs utiles…
Y a-t-il une démarche qui facilite la mise en pratique du pardon ?
Bien que les cas et les circonstances soient tellement variés et personnels, osons et proposons une démarche susceptible de favoriser le pardon chez l’agressé :
- a) Préparation : Créer les conditions pour se retrouver seul et faire le point. Se mettre au vert, au calme. Prendre de la distance avec les évènements. Se donner les moyens de se relaxer, de s’oxygéner pour mieux se concentrer.
- b) Ecrire avec précision les faits de l’agression subie. Le fait de coucher sur le papier les détails de la situation vécue, de repréciser le passage à l’acte, est un moment important. Il faut prendre son temps et définir avec soin ce qui, en nous, a été agressé.
- c) Décider : pour rompre avec la douleur, le ressentiment, l’amertume, la vengeance, il convient de faire acte de volonté. Décider de ne plus souffrir, refuser d’être brûlé de l’intérieur par une aigreur persistante. Cela renvoie à la prise de conscience d’une aide extérieure. Mais l’important est bien de vouloir personnellement entamer un processus de résolution du mal.
- d) Reconnaître les faits sans chercher à se justifier : L’agression, l’offense, doit être reconnue sans appréciation de jugement. C’est une des phases les plus difficiles, car nos mécanismes de défense ont ce mal récurrent à être très réactifs.
- e) S’accepter et prendre soin de soi : La priorité est de se centrer sur soi. En général, dans les cas de faits divers, les agresseurs sont relativement sereins. Ils ne se posent pas de questions de conscience. Ils ont pour la plupart vécu un moment jouissif. C’est l’agressé qui est mal. Il vit une double peine : l’agression du moment, et la douleur qui suit. D’où l’importance de prendre soin de soi avec des premiers soins, comme aux urgences d’un hôpital.
- f) Commencer par se pardonner : Il faut se pénétrer de l’idée qu’il n’y a rien d’impardonnable en soi. Se pardonner à soi-même, c’est se donner le droit à l’erreur. C’est accepter d’être envahi de sentiments négatifs. Dans un premier temps, c’est une réaction normale. Ce qui ne l’est pas, c’est de s’accommoder de cette situation, voire même de l’entretenir dans la durée.
- g) Chercher à comprendre les motivations de l’agresseur : Cette démarche peut paraître incongrue, elle n’en est pas moins utile. Comprendre n’équivaut pas à excuser. Le sens de cette proposition est de renouer avec le concept d’humanité. Sur un plan chrétien, rappelons-nous que nous sommes tous pêcheurs, c'est-à-dire, tous égaux devant les agressions.
- h) Donner un sens à sa blessure : les conflits et les agressions font partie malheureusement ou heureusement de nos marches. On ne peut les mettre de côté, faire comme si ils n’existaient pas. Les affronter, c’est apprendre à grandir. Surmonter l’obstacle, c’est entrer dans une dynamique de vie positive. On ne gagne rien à ressasser ses erreurs ou ses malheurs. Il faut cesser de s’apitoyer sur son sort.
- i) Renoncer au pardon facile : Vouloir classer l’agression d’un revers de main est peine perdue. On peut se croire supérieur ou se donner l’impression d’être plus intelligent en accordant un pardon facile... En fait, le déni de la réalité fera surgir, un peu plus tard, la profondeur de la blessure. On ne gagne rien à faire l’économie d’un vrai pardon.
- j) Accepter une aide extérieure : au lieu de nous épuiser à refuser le pardon, ou à vouloir le pratiquer sans conviction, ouvrons-nous à une aide extérieure. Pour nous chrétiens, appuyons-nous sur la bonté de Dieu. Accueillons les bienfaits de sa grâce. Le Christ nous a invités à pratiquer le pardon. Il l’a lui-même accordé dans des circonstances dramatiques. Il a franchi la frontière de l’impossible (cf. Luc 23 : 34). Dans toutes les situations, même extrêmes, l’apôtre Jacques nous dit : « la prière agissante du juste a une grande efficacité » Jacques 5 : 15, version LSG.
Evitons de croire que nous pourrons par nous-mêmes solutionner tous nos problèmes…
- k) Accueillir le pardon de Dieu pour soi : Laissons-nous envahir par la manifestation concrète de l’amour de Dieu. Laissons-nous aimer et pardonner par notre Père céleste. Cette démarche si insolite pour le non-croyant est pourtant porteuse de bienfaits inestimables. Quand on se sent vraiment aimé et pardonné, il est plus facile d’accorder à autrui ce que l’on a déjà reçu. Aimer, c’est apprendre à pardonner. On mesure sa capacité d’aimer à sa force de pardon.
- L) Quel est mon projet dans ma relation à autrui ? Puisque nous sommes des humains appelés à vivre en lien les uns avec les autres, quel est mon projet de vie ? Quels sont mes choix : Guerre ou paix ? Usage de la force ou maîtrise de soi ? Tensions permanentes ou apaisements ? Séparation ou réconciliation ? Prouver que l’on a raison à tout prix, ou prendre en compte d’autres ressentis ? Il est quelque part nécessaire de pointer tout ce qui peut parasiter une relation épanouissante et heureuse.
Mais il y a de merveilleux trésors à découvrir sur l’île du pardon.
Jacques Eychenne
PS. LSG, version Louis Segond, éd. 1982 ; NBS, version Nouvelle Bible Segond.
Notes :
- « Du bon usage de la haine et du pardon », de Gabrielle Rubin, éd. Payot, 2007
- « Les paradoxes du pardon », de Nicole Fabre, éd. Albin Michel, 2007.
- Les textes clés du pardon : (liste non-exhaustive !)
Psaumes 129 : 4, 64 : 4, 86 : 5, 25 : 18. Esaïe 55 : 7. Néhémie 9 : 17. Matthieu 6 : 12, 26 : 28 ; Marc 1 : 4 ; 3 : 29 ; Luc 1 : 77, 4 : 18, 7 : 47, 9 : 17, 23 : 24 ; Actes 5 : 31, 10 : 43 ; Ephésiens 1 : 7, 4 : 26,32 ; Colossiens 3 : 13. Hébreux 9 : 22 ; 10 : 18.